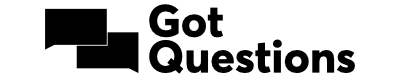Question
Quelles sont les cinq voies de Thomas d'Aquin ?
Réponse
Les cinq voies de Thomas d'Aquin sont les principaux arguments rationnels utilisés par Thomas d'Aquin pour défendre l'existence du Dieu chrétien. Bien que les cinq voies soient couramment mentionnées dans les discussions sur l'histoire et la philosophie, elles sont facilement mal comprises. Les critiques ont tour à tour compliqué à l'excès, simplifié à l'extrême ou simplement mal interprété sa véritable intention qui était de démontrer un argument général, objectif et rationnel en faveur de l'existence de Dieu à l'aide d'observations courantes.
Une erreur courante consiste à supposer que Thomas d'Aquin a voulu que les cinq voies constituent un argument complet et irréfutable en faveur de l'existence de Dieu. En réalité, il ne les considérait que comme un début, un moyen de soutenir l'existence de Dieu pour ceux qui ne s'intéressaient qu'aux arguments fondés sur la raison et l'observation. En tant que telles, les Cinq voies doivent être considérées comme une introduction à l'idée de l'existence de Dieu, et non comme la somme totale de la théologie chrétienne.
D'autre part, certains critiques des cinq voies les simplifient à l'excès. Cela va souvent de pair avec une interprétation erronée. L'œuvre de Thomas d'Aquin a été achevée au 13e siècle, et la terminologie qu'il utilise est donc subtilement différente de la langue moderne. Par exemple, le mot "mouvement" utilisé par Thomas d'Aquin avait le sens de "changement", et non de déplacement physique. L'interprétation des Cinq Voies exige de considérer attentivement l'intention réelle de Thomas d'Aquin lorsqu'il a exposé ses arguments. Prendre les déclarations de manière trop simpliste ou sans comprendre les autres déclarations philosophiques de Thomas d'Aquin est une approche injuste et trompeuse.
Il existe de nombreuses façons de présenter les cinq voies de Thomas d'Aquin. Leur simplicité (relative) peut être trompeuse ; chacune de ces cinq affirmations peut être disséquée, nuancée et débattue à l'infini. Pour les besoins de la discussion, les principales affirmations peuvent être résumées comme suit :
I. L'argument du changement ("mouvement")
Le changement est immédiatement apparent dans l'univers, dans le sens où les choses passent d'un état "potentiel" à un état "réel". Mais ce potentiel concerne quelque chose qui n'existe pas encore et qui nécessite donc quelque chose d'autre pour l'actualiser. Ce qui l'actualise doit à son tour être actualisé par quelque chose d'autre. Logiquement, cette chaîne de changements ne peut pas être infinie, sinon rien n'aurait jamais changé. Par conséquent, il doit exister une chose inchangée et immuable qui actualise tous les autres changements. Ce principe n'est pas lié au temps ou à une séquence d'événements. Il souligne plutôt la nécessité d'avoir quelque chose capable de provoquer les changements que nous observons : Dieu, le Moteur Immuable.
En d'autres termes, le premier des arguments de Thomas d'Aquin en faveur de l'existence de Dieu souligne que tous les changements sont le résultat d'un autre changement. Mais cette chaîne de changements ne peut être infinie, de sorte qu'il doit y avoir une chose inchangée originelle qui est en fin de compte responsable de tous les autres changements.
II. L'argument de la causalité
La cause et l'effet sont évidents dans l'univers. Tout ce qui se produit est causé par quelque chose d'autre. Tous les événements dépendent d'un autre événement ou d'une autre chose pour se produire. Une chose ne peut être la cause d'elle-même, sinon elle n'existerait jamais. Logiquement, cette chaîne de causalité ne peut être infinie, sinon rien ne serait jamais apparu. Par conséquent, il doit y avoir une chose non causée qui cause toutes les autres choses. Cet argument n'est pas lié au temps ou à une séquence d'événements. Il prend plutôt en compte le fait que toutes les choses dépendent de quelque chose d'autre pour leur existence.
En d'autres termes, la deuxième façon qu'a Thomas d'Aquin de démontrer l'existence de Dieu est basée sur le fait que tous les effets sont causés par un autre événement, qui à son tour est l'effet d'une autre cause. Mais cette chaîne de causalité ne pouvant être infinie, il doit donc y avoir une cause non causée : Dieu, la cause première.
III. L'argument de la contingence
Rien de ce que nous observons dans l'univers n'est nécessaire ; rien n'a besoin d'exister en soi. Nous observons souvent des choses qui cessent d'exister, victimes de la mort, de la destruction ou de la décomposition. En fin de compte, toutes les choses non nécessaires cessent d'exister. Mais s'il était possible que tout cesse d'exister, et si le temps passé était infini, alors toutes les choses auraient déjà cessé d'exister. Il ne resterait rien du tout. Le fait que quelque chose existe, même maintenant, signifie qu'il doit y avoir une chose qui ne peut pas cesser d'exister, une chose qui doit nécessairement exister. Il doit y avoir une chose qui n'est pas contingente, c'est-à-dire dont l'existence ne dépend de rien d'autre. Cette chose doit être.
En d'autres termes, le troisième argument d'Aquin ou la façon de prouver l'existence de Dieu est que, si tout était impermanent, tout finirait par cesser d'être. Par conséquent, il doit y avoir au moins une chose qui doit nécessairement exister (une chose non contingente) : Dieu, l'Être nécessaire.
IV. L'argument de la perfection
Chaque caractéristique que nous voyons, dans chaque objet, est comparée à une norme : santé, moralité, force, etc. Le fait que nous percevions instinctivement des degrés dans ces domaines implique qu'il existe une norme ultime par rapport à laquelle juger cette propriété. Et toutes les propriétés comparatives ont en commun le sens de la "perfection". Cela signifie qu'il doit y avoir une norme ultime de "perfection" à partir de laquelle juger toutes les autres propriétés ; ces objets ne peuvent pas être la source ou la définition de cette propriété en soi.
En d'autres termes, le quatrième argument de l'Aquin en faveur de l'existence de Dieu souligne que, pour parler de "bonté" ou de "puissance", nous devons disposer d'une norme absolue par rapport à laquelle juger ces termes ; il doit y avoir quelque chose d'autre dont ils tirent en fin de compte cette caractéristique : Dieu, la norme ultime.
V. L'argument de la finalité
Beaucoup de choses dans l'univers "poussent" vers un but particulier, et non vers des résultats aléatoires. Les aimants "poussent" à chercher du métal ou à aligner leurs pôles. Les graines "poussent" à devenir des plantes adultes, et non des animaux. Cette régularité, par opposition au hasard, est le signe d'un but, d'une intention ou d'une intelligence. Cependant, les aimants, les graines et autres n'ont pas d'intelligence propre. Par conséquent, leur "dynamisme" doit être le résultat d'une intelligence extérieure qui fixe ou conçoit leur comportement. D'une manière ou d'une autre, tous les buts et toutes les fonctions doivent provenir d'une entité intelligente.
En d'autres termes, la cinquième façon qu'a Thomas d'Aquin de démontrer l'existence de Dieu implique le fait que la matière et l'énergie inanimées ne font pas preuve d'intelligence ou de finalité. Lorsque nous voyons quelque chose d'inintelligent qui semble avoir un but spécifique ou qui remplit un rôle utile, nous devons supposer que cette chose a été dotée de ce but par une autre intelligence. En fin de compte, cela nous conduit à Dieu, le Grand Concepteur.
Les cinq voies aujourd'hui
Comme nous pouvons le constater, il existe de grandes similitudes entre les cinq voies de Thomas d'Aquin et de nombreux autres arguments courants en faveur de l'existence de Dieu. Toutefois, il convient de garder à l'esprit certaines distinctions.
Les trois premiers arguments de Thomas d'Aquin ont un thème commun : la causalité, la logique, etc. conduisent à la déduction de l'existence d'une divinité. L'argument le plus fréquemment utilisé dans le monde moderne est étroitement lié au deuxième argument, la causalité, et est généralement appelé simplement l'argument cosmologique.
Fondamentalement, le quatrième argument est presque identique à l'argument ontologique présenté par Anselme. Thomas d'Aquin y voit cependant une distinction, car il se concentre sur la source de l'existence d'une chose. En d'autres termes, Thomas d'Aquin soutenait que la bonté ou la puissance d'un objet fini ne pouvait provenir que d'une autre source, plus importante. L'argument ontologique d'Anselme, techniquement, est plus axé sur le concept générique de "perfection". Néanmoins, il n'est pas rare que la quatrième voie de Thomas d'Aquin soit assimilée à l'argument ontologique.
Le cinquième argument, également connu sous le nom d'argument téléologique d'Aquin, est similaire à l'argument moderne de l'Intelligent Design. Cependant, l'argument d'Aquin suppose que les composants individuels ont une certaine forme d'impulsion ou d'initiative en eux-mêmes. Le dessein intelligent, quant à lui, suppose que les composants individuels (par exemple, les atomes ou l'énergie) n'ont pas de but ou de fonction particulière en dehors d'une intervention intelligente. Cette distinction est triviale pour la plupart des besoins actuels. Pourtant, à proprement parler, la cinquième voie de Thomas d'Aquin n'est pas la même que l'Intelligent Design moderne.
Les chercheurs continuent de débattre de la validité des cinq voies de Thomas d'Aquin. Quelle que soit l'utilité qu'on leur accorde dans un contexte moderne, leur importance dans les domaines de la théologie et de la philosophie ne saurait être surestimée. Lorsqu'elles sont correctement comprises comme le "niveau de base" d'une défense rationnelle de l'existence de Dieu, elles sont des outils utiles.
Une erreur courante consiste à supposer que Thomas d'Aquin a voulu que les cinq voies constituent un argument complet et irréfutable en faveur de l'existence de Dieu. En réalité, il ne les considérait que comme un début, un moyen de soutenir l'existence de Dieu pour ceux qui ne s'intéressaient qu'aux arguments fondés sur la raison et l'observation. En tant que telles, les Cinq voies doivent être considérées comme une introduction à l'idée de l'existence de Dieu, et non comme la somme totale de la théologie chrétienne.
D'autre part, certains critiques des cinq voies les simplifient à l'excès. Cela va souvent de pair avec une interprétation erronée. L'œuvre de Thomas d'Aquin a été achevée au 13e siècle, et la terminologie qu'il utilise est donc subtilement différente de la langue moderne. Par exemple, le mot "mouvement" utilisé par Thomas d'Aquin avait le sens de "changement", et non de déplacement physique. L'interprétation des Cinq Voies exige de considérer attentivement l'intention réelle de Thomas d'Aquin lorsqu'il a exposé ses arguments. Prendre les déclarations de manière trop simpliste ou sans comprendre les autres déclarations philosophiques de Thomas d'Aquin est une approche injuste et trompeuse.
Il existe de nombreuses façons de présenter les cinq voies de Thomas d'Aquin. Leur simplicité (relative) peut être trompeuse ; chacune de ces cinq affirmations peut être disséquée, nuancée et débattue à l'infini. Pour les besoins de la discussion, les principales affirmations peuvent être résumées comme suit :
I. L'argument du changement ("mouvement")
Le changement est immédiatement apparent dans l'univers, dans le sens où les choses passent d'un état "potentiel" à un état "réel". Mais ce potentiel concerne quelque chose qui n'existe pas encore et qui nécessite donc quelque chose d'autre pour l'actualiser. Ce qui l'actualise doit à son tour être actualisé par quelque chose d'autre. Logiquement, cette chaîne de changements ne peut pas être infinie, sinon rien n'aurait jamais changé. Par conséquent, il doit exister une chose inchangée et immuable qui actualise tous les autres changements. Ce principe n'est pas lié au temps ou à une séquence d'événements. Il souligne plutôt la nécessité d'avoir quelque chose capable de provoquer les changements que nous observons : Dieu, le Moteur Immuable.
En d'autres termes, le premier des arguments de Thomas d'Aquin en faveur de l'existence de Dieu souligne que tous les changements sont le résultat d'un autre changement. Mais cette chaîne de changements ne peut être infinie, de sorte qu'il doit y avoir une chose inchangée originelle qui est en fin de compte responsable de tous les autres changements.
II. L'argument de la causalité
La cause et l'effet sont évidents dans l'univers. Tout ce qui se produit est causé par quelque chose d'autre. Tous les événements dépendent d'un autre événement ou d'une autre chose pour se produire. Une chose ne peut être la cause d'elle-même, sinon elle n'existerait jamais. Logiquement, cette chaîne de causalité ne peut être infinie, sinon rien ne serait jamais apparu. Par conséquent, il doit y avoir une chose non causée qui cause toutes les autres choses. Cet argument n'est pas lié au temps ou à une séquence d'événements. Il prend plutôt en compte le fait que toutes les choses dépendent de quelque chose d'autre pour leur existence.
En d'autres termes, la deuxième façon qu'a Thomas d'Aquin de démontrer l'existence de Dieu est basée sur le fait que tous les effets sont causés par un autre événement, qui à son tour est l'effet d'une autre cause. Mais cette chaîne de causalité ne pouvant être infinie, il doit donc y avoir une cause non causée : Dieu, la cause première.
III. L'argument de la contingence
Rien de ce que nous observons dans l'univers n'est nécessaire ; rien n'a besoin d'exister en soi. Nous observons souvent des choses qui cessent d'exister, victimes de la mort, de la destruction ou de la décomposition. En fin de compte, toutes les choses non nécessaires cessent d'exister. Mais s'il était possible que tout cesse d'exister, et si le temps passé était infini, alors toutes les choses auraient déjà cessé d'exister. Il ne resterait rien du tout. Le fait que quelque chose existe, même maintenant, signifie qu'il doit y avoir une chose qui ne peut pas cesser d'exister, une chose qui doit nécessairement exister. Il doit y avoir une chose qui n'est pas contingente, c'est-à-dire dont l'existence ne dépend de rien d'autre. Cette chose doit être.
En d'autres termes, le troisième argument d'Aquin ou la façon de prouver l'existence de Dieu est que, si tout était impermanent, tout finirait par cesser d'être. Par conséquent, il doit y avoir au moins une chose qui doit nécessairement exister (une chose non contingente) : Dieu, l'Être nécessaire.
IV. L'argument de la perfection
Chaque caractéristique que nous voyons, dans chaque objet, est comparée à une norme : santé, moralité, force, etc. Le fait que nous percevions instinctivement des degrés dans ces domaines implique qu'il existe une norme ultime par rapport à laquelle juger cette propriété. Et toutes les propriétés comparatives ont en commun le sens de la "perfection". Cela signifie qu'il doit y avoir une norme ultime de "perfection" à partir de laquelle juger toutes les autres propriétés ; ces objets ne peuvent pas être la source ou la définition de cette propriété en soi.
En d'autres termes, le quatrième argument de l'Aquin en faveur de l'existence de Dieu souligne que, pour parler de "bonté" ou de "puissance", nous devons disposer d'une norme absolue par rapport à laquelle juger ces termes ; il doit y avoir quelque chose d'autre dont ils tirent en fin de compte cette caractéristique : Dieu, la norme ultime.
V. L'argument de la finalité
Beaucoup de choses dans l'univers "poussent" vers un but particulier, et non vers des résultats aléatoires. Les aimants "poussent" à chercher du métal ou à aligner leurs pôles. Les graines "poussent" à devenir des plantes adultes, et non des animaux. Cette régularité, par opposition au hasard, est le signe d'un but, d'une intention ou d'une intelligence. Cependant, les aimants, les graines et autres n'ont pas d'intelligence propre. Par conséquent, leur "dynamisme" doit être le résultat d'une intelligence extérieure qui fixe ou conçoit leur comportement. D'une manière ou d'une autre, tous les buts et toutes les fonctions doivent provenir d'une entité intelligente.
En d'autres termes, la cinquième façon qu'a Thomas d'Aquin de démontrer l'existence de Dieu implique le fait que la matière et l'énergie inanimées ne font pas preuve d'intelligence ou de finalité. Lorsque nous voyons quelque chose d'inintelligent qui semble avoir un but spécifique ou qui remplit un rôle utile, nous devons supposer que cette chose a été dotée de ce but par une autre intelligence. En fin de compte, cela nous conduit à Dieu, le Grand Concepteur.
Les cinq voies aujourd'hui
Comme nous pouvons le constater, il existe de grandes similitudes entre les cinq voies de Thomas d'Aquin et de nombreux autres arguments courants en faveur de l'existence de Dieu. Toutefois, il convient de garder à l'esprit certaines distinctions.
Les trois premiers arguments de Thomas d'Aquin ont un thème commun : la causalité, la logique, etc. conduisent à la déduction de l'existence d'une divinité. L'argument le plus fréquemment utilisé dans le monde moderne est étroitement lié au deuxième argument, la causalité, et est généralement appelé simplement l'argument cosmologique.
Fondamentalement, le quatrième argument est presque identique à l'argument ontologique présenté par Anselme. Thomas d'Aquin y voit cependant une distinction, car il se concentre sur la source de l'existence d'une chose. En d'autres termes, Thomas d'Aquin soutenait que la bonté ou la puissance d'un objet fini ne pouvait provenir que d'une autre source, plus importante. L'argument ontologique d'Anselme, techniquement, est plus axé sur le concept générique de "perfection". Néanmoins, il n'est pas rare que la quatrième voie de Thomas d'Aquin soit assimilée à l'argument ontologique.
Le cinquième argument, également connu sous le nom d'argument téléologique d'Aquin, est similaire à l'argument moderne de l'Intelligent Design. Cependant, l'argument d'Aquin suppose que les composants individuels ont une certaine forme d'impulsion ou d'initiative en eux-mêmes. Le dessein intelligent, quant à lui, suppose que les composants individuels (par exemple, les atomes ou l'énergie) n'ont pas de but ou de fonction particulière en dehors d'une intervention intelligente. Cette distinction est triviale pour la plupart des besoins actuels. Pourtant, à proprement parler, la cinquième voie de Thomas d'Aquin n'est pas la même que l'Intelligent Design moderne.
Les chercheurs continuent de débattre de la validité des cinq voies de Thomas d'Aquin. Quelle que soit l'utilité qu'on leur accorde dans un contexte moderne, leur importance dans les domaines de la théologie et de la philosophie ne saurait être surestimée. Lorsqu'elles sont correctement comprises comme le "niveau de base" d'une défense rationnelle de l'existence de Dieu, elles sont des outils utiles.